Retour vers Luigi Malerba
Depuis des années j'ai délaissé Luigi Malerba mais aujourd'hui la découvert de cette présentation de deux de ses romans m'y renvoient avec plaisir. Je n'ai croisé cet écrivain italien que 20 vingt ans après cette chronique et je vais évoquer ma passion dans les artuiles suivants. J-P Damaggio
Luigi MALERBA : Le serpent cannibale, traduit de l'italien par Michel CAUSSE ; Le saut de la mort, traduit par Jean-Noël SCHIFAN0. (Fasquelles).
« Elle disait, tu n'as pas idée ce que nous pouvons être nombreux là en bas ; nous sommes des milliards et des milliards. Pense donc certains sont là depuis le commencement du monde. Où qu'on aille, il y a toujours quelqu'un, parce que tout est plein... Mais alors, disais-je, où es-tu allée finir ? Comment s'appelle cet endroit où tu te trouves ? Il n'a pas de nom, disait Myriam ; et s'il a un nom nous ne le connaissons pas ; nous ne savons rien et nous ne voyons rien. De temps en temps quelqu'un met le pied où il ne faut pas et il choit plus bas. On entend les hurlements de ceux qui tombent, puis plus rien, parce qu'ils tombent vraiment tout en bas. Ils font ainsi de la place pour les nouveaux arrivants. C'est bien pour ne pas tomber en bas que nous nous agrippons les uns aux autres, mais...[1] »
Myriam parle des trépassés ; mais nous savons bien, nous, que c'est sur ce mode que nous existons aussi. Ajoutons que Myriam n'existe pas. Alors qui parle et de quoi ? Si nous avons cru un moment qu'elle était l'amante du héros du Serpent cannibale, nous commençons bien vite à douter, car le héros évidemment délire. Ce qui est donné à lire au lecteur, ici, c'est donc l'histoire imaginée par l'auteur, d'une passion imaginée par le héros, avec une partenaire toute docile mais, hélas, inventée ; et des rencontres, des jeux érotiques et un meurtre cannibalesque, halluciné. L'indice de réalité qui nous fait dire que nous ne rêvons pas, quand effectivement nous ne rêvons pas, est si mince ! Plus mince encore dans un roman. La géniale astuce de Malerba consiste dans la subtilisation de l'indice de réalité, par une invention au second degré qui frise la prestidigitation.
Pour le héros, le seul salut c'est le « saut périlleux » ou, si l'on veut, un certain chant qui maintiendrait un haut niveau de plaisir comme le chanteur tient sa note, sans laisser tomber sa voix. Si l'on tombe on meurt. En bas c'est la nuit, le néant, l'inexistence. Ce ne sont pas des métaphores : la voix (premier roman) et le saut de la mort (second roman), et de même le plaisir sexuel, sont des analogues qu'il faut prendre au pied de la lettre. Pour chanter, pour sauter et pour jouir, il faut respirer suivant un certain rythme qui reste à trouver et si l'on ne respire pas, on meurt.
Vivants, nous faisons un bruit continu comme la rumeur des avions ou des moteurs ou des cigales ou de la radio quand parle le Pape. C'est sur ce bruit de fond que commence Le saut de la mort. Le fait est que les humains parlent sans discontinuer. On pourrait paraphraser la Zazie de Queneau et dire : mais quècequis'dit'donctant ? Qu'ont ils de si pressé à se dire, qu'ils ne prennent pas le temps de manger, de fumer ni de marcher ? Joseph s'étonne. On sait que l'étonnement est le commencement de la philosophie. Pour lui c'est le commencement de la folie. Lui, Joseph n'a personne à qui parler. Faute d'un interlocuteur, le discours retombe en pluie ou en cendres sur la page du romancier. Joseph répercute cet inquiétant bruit de fond, composé de multiples échos. La seconde trouvaille de Malerba est dans l'utilisation systématique et pourtant naturelle, de cette écholalie qui définit tout langage, une fois proféré.
Et que dit l'écho ? Il dit : on a tué ; qui a tué ? Tous les Joseph, dénommés Joseph, répondent aussitôt : peut-être moi ; et se mettent à courir. Il faut bien en effet que quelqu'un ait laissé le couteau dans le pré aux environs de la Tour Médiévale. Un couteau ne pousse pas tout seul dans un pré. Et s'il n'y a pas de couteau ? Alors les minutieuses, admirables, exhaustives, enquêtes de la police, dite la Scientifique, tombent à l'eau. Or il n'y a pas de couteau. Il n'y en a pas moins un mort et donc un coupable. C'est un fait qu'il y a de la mort partout, tout le temps ; dans le ciel, en Asie, et en ce moment dans ce pré aux environs de la Tour Médiévale... La Plaine qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Rome est une « table rase ». Il n'y a rien là-dessus et pourtant la mort rôde. On prétend que cette plaine a fait l'objet de nombreux relevés, prospections, réseaux et travaux divers. »... Allez donc vous cacher vous ferez mieux ; ou bien changez de métier. LA UN HOMME EST MORT et vous ne vous êtes aperçu de rien... » Pourtant sur cette table rase on ne peut que la voir, la mort. La preuve c'est que tout le monde fuit vers Rome où il est plus facile de se cacher et de lui échapper ou vers la lune, loin de la terre mortifère. Mais rien ne sert de fuir, à la vérité ; rien ne sert de bavarder non plus ; car LA MORT C'EST UN BIEN VILAIN ENDROIT POUR BAVARDER.
Et notre Joseph poursuit son interminable monologue : ce qui le fait fuir, c'est la peur ; ce qui le fait parler, c'est la peur. Son discours a, grâce au délire, sa logique propre. Ainsi par exemple : je marche parce que ma bicyclette a un pneu crevé. Je vais donc à pied. Et si quelqu'un me guette ? Le clou a dû être mis exprès. Je vois le meurtrier. Je sue. Il fume comme une mitrailleuse pendant la guerre. Inutile de chercher un abri. Il n'y a pas d'abri contre les bombardements. Jette-toi contre terre. Les avions descendent en piqué. Confonds-toi avec la terre. Quel bruit. Non ce sont les cigales. Mais il n'y a pas de cigale. C'est mon propre cœur. Non c'est le concertino du Second programme et il ne me plaît pas. Non ? Tu es bien difficile...
Il n'est pas possible de dire plus fortement et plus densément que la mort rôde ; qu'elle surprend le plus innocent promeneur ; qu'elle l'assaille sur la terre et dans les airs et qu'il est bien vain et bien ridicule et bien dérisoire et peut-être criminel, de jouer des musiquettes pour le distraire. L'art, l'amour, la science ? De jolis bruits ou de vilains bruits... Il reste que le meurtrier de Joseph est peut-être Joseph soi-même. S'il saigne c'est sans doute comme le suggère Rosa (ou Rosella ou Rossana ou Rossanda ou Rosalda...) qu'il s'est fait une entaille avec un canif, comme ce vieux trouvé dans le pré aux environs de la Tour médiévale.
S'il ne se suicide pas, alors à coup sûr son fils le tuera. Ce fils dont il ne sait pas comment il l'a fait. Et si ce n'est pas son fils, alors ce sera l'oxyde de carbone que produit la Grande Métropole. Il est bien vrai que la Grande Métropole mange tout et jusqu'à ce pré où le vieillard a été censément trouvé mort. Comment dire dès lors que quelqu'un l'a tué ? Il serait très simple et l'on aurait tôt fait, avec les moyens dont dispose l'humanité, de trouver le coupable. Non. Ou bien nous sommes tous coupables ; ou bien il n'y a pas de coupable. Dans ces conditions, à moins de devenir fou — ce que s'empresse de faire Joseph pour ne plus avoir à penser —il n'y a pas de solution. Et la vie cependant continue, comme une roue. A moins de faire des sauts périlleux, des sauts mortels, personne n'évite la roue. Chanteur ou acrobate, l'homme est voué aux tours de force et le résultat est maigre.
Dérisoire. Mais il y a un art de la dérision. Celui de Malerba, c'est de l'acrobatie en rase-motte ; à ras du quotidien. Il absorbe nos moindres gestes et tous nos gestes ; la vie humaine ainsi photographiée, prend l'allure d'un délire au jour le jour. Etrange roman policier que ce Saut de la mort. Drôle de rire que celui qui secoue le lecteur à voir courir ce pauvre Joseph comme une fourmi affolée. Des morceaux de phrases sont là, posées comme sur un damier. Ils se déplacent suivant une logique sûre. Nous sommes loin du déjà classique monologue intérieur ou des procédés de collage ou de discours complexes ou des « anti-discours » qui se répandent comme une lèpre. Le roman de Malerba est une chambre d'échos où l'auteur a enfermé son héros, un Joseph, dénommé Joseph, qui nous fait mesurer la distance parcourue depuis le Joseph K. de Kafka, puisqu'il n'a même plus de prénom propre, ni même d'identité propre, ni même d'existence propre.
Malerba, peu connu en France, a eu toutefois le prix Médicis en même temps que Camille Bourniquel. Il était temps. C'est un grand romancier et tout simplement un grand écrivain.
Gennie Luccioni.

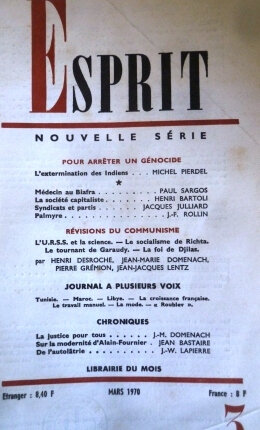


/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F05%2F83%2F1182834%2F126929788_o.jpg)
/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F06%2F38%2F1182834%2F126929771_o.jpg)
/image%2F1367097%2F20240308%2Fob_4969af_manuelvazquezmontalban1.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F02%2F98%2F1182834%2F134525279_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F27%2F89%2F1182834%2F126134326_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F39%2F35%2F1182834%2F122208944_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F04%2F96%2F1182834%2F105374241_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F75%2F15%2F1182834%2F101409845_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F89%2F84%2F1182834%2F101203611_o.jpg)